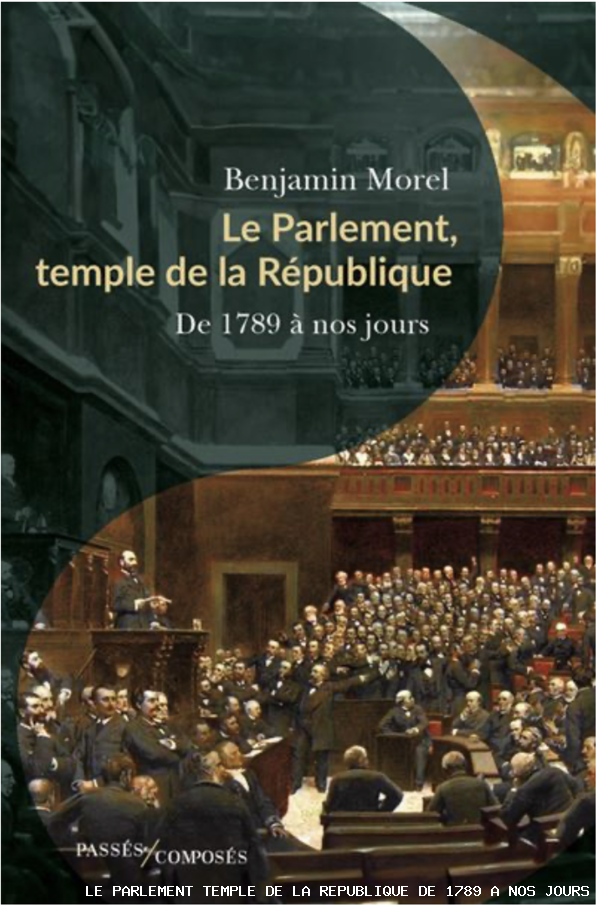Le Parlement, temple de la République
De 1789 à nos jours
Institution marginalisée, parfois méprisée de la Ve République, le Parlement montre pourtant que rien ne peut se faire sans lui. La chose est d'autant plus vraie depuis sa récente dissolution décidée par Emmanuel Macron. Son histoire se confond avec celle de la République. Toutefois, son rôle et la manière dont on conçoit sa fonction ont évolué. Représentation imparfaite d'un peuple qui devait le contrôler, il est devenu un rouage administratif sous l'Empire. Chambre d'aristocrates puis de notables, c'est par la délibération qu'il acquiert, au XIXe siècle, un rôle central. Chargés de définir l'intérêt général, députés et sénateurs développent les techniques de débat et d'éloquence, participant à créer une culture parlementaire. Derrière cette histoire chaotique réside celle de la République et de la démocratie. Même quand, comme sous la Restauration, les chambres se voulurent parangon de la réaction, leurs actions poussèrent à une libéralisation du régime. Même quand le Second Empire voulut les réduire, il comprit qu'il ne pourrait survivre qu'en s'appuyant sur les assemblées. Le fait parlementaire est têtu. Attaquées ou données pour mortes, les chambres ont survécu aux rois et aux empereurs, aux guerres et aux crises. Fil rouge et force dynamique de l'histoire de France depuis deux siècles, le Parlement est au centre de notre modernité politique. En voici son histoire, publique, secrète, intime, vivante, totale.
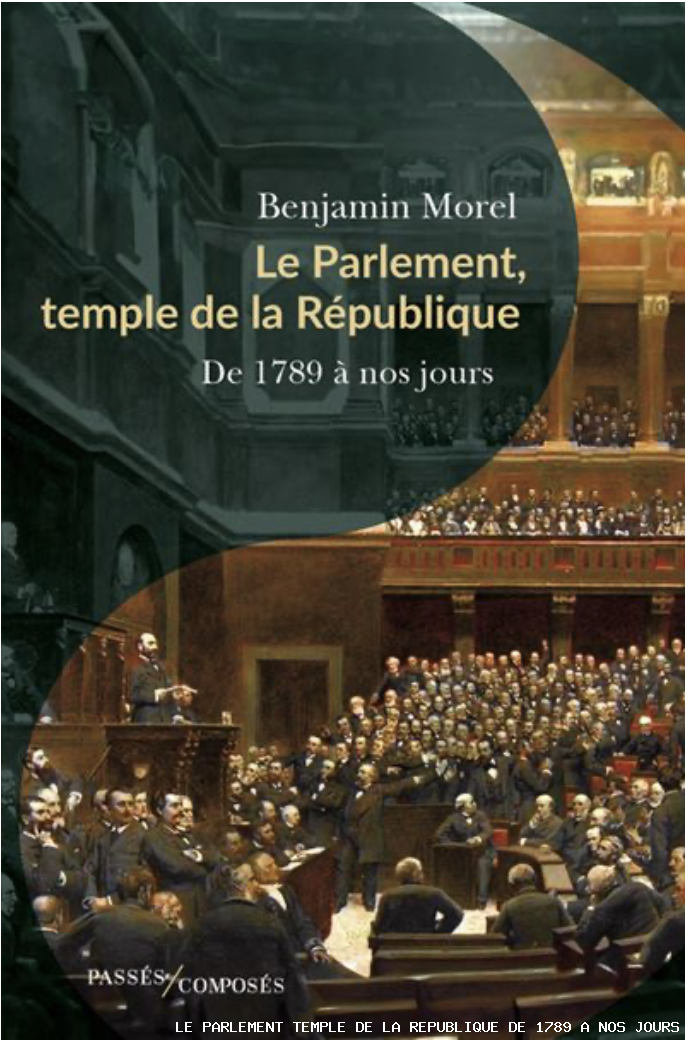
Des murs vides. En prenant la décision de dissoudre l’Assemblée le 9 juin 2024, le président de la République mettait instantanément fin aux mandats des 577 députés. Les textes discutés étaient caduques, les groupes dissous, les commissions sans membres. Pendant un mois et demi, la France allait vivre sans Parlement, le Sénat renonçant à siéger par courtoisie républicaine. Pourtant, les lieux restent. Le Palais Bourbon se tient encore sur les rives de la Seine, attendant que ses nouveaux locataires ne se réunissent en plein cœur de l’été. Lorsque, dans les années 1960, il fut envisagé de déplacer l’Assemblée nationale ailleurs que dans ses murs, les députés rechignèrent. Théoriquement, pourtant, leur légitimité n’a pas à voir avec ces murs, véritablement acquis en 1827 et dont Napoléon, qui en fut le maître d’ouvrage, avait jugé l’esthétique bonne à livrer aux canons. Toutefois, les Chambres ne sont pas que des organes politiques, destinés à exprimer une volonté et élus à dessein pour représenter le peuple souverain. Le Parlement est également, et peut-être d’abord, une institution à la légitimité ancrée dans l’histoire. N’est pas Mirabeau ou Bailly qui veut. C’est le privilège de la Constituante de se réunir au Jeu de Paume en proclamant que sa légitimité n’a pour source que sa composition. Les fauteuils des Chambres en témoignent, où sont inscrits les noms des parlementaires les plus éminents qui les ont jadis occupés. Plus qu’aucun autre organe, le Parlement est le produit d’une histoire longue et complexe, faite de grands événements, mais surtout de pratiques, d’habitudes et de lieux1. Pour comprendre l’Assemblée nationale et le Sénat d’aujourd’hui, qui, au titre de l’alinéa 2 de l’article 24 de notre Constitution, constituent le Parlement, il faut dépasser leur composition actuelle. Il n’est pas non plus suffisant de remonter à 1958. Ces assemblées sont les héritières d’une longue histoire durant laquelle les ruptures sont nombreuses, mais jamais absolues. Il faut ainsi saisir le rapport entre continuité et fractures au sein des cadres politiques, juridiques et symboliques qui entourent leur action2. Cet ouvrage ne se veut donc pas seulement un livre d’histoire, car l’histoire n’est jamais tout à fait passée dans les Chambres. Elle marque les rites, les pratiques, les fantasmes… les phobies aussi, parfois.
Un Parlement, ce sont d’abord des hommes et, depuis 1944, des femmes, qui tentent de tenir un rôle commun dans un environnement politique et social en perpétuelle recomposition. Au-delà des individus qui le forment, pour un jour ou pour beaucoup plus, le Parlement est surtout une institution qui s’inscrit dans une tradition, de législature en législature, de régime en régime, comme en témoigne la continuité relative des règlements intérieurs. Par des pierres successivement empilées, il constitue un « monde de pensée3 » qui s’impose aux nouveaux entrants et que, consciemment ou pas, ils transmettront à ceux qui les suivront. Concevoir le Parlement, c’est donc comprendre l’évolution de son rôle, de sa composition certes, mais aussi de ses procédures, des conditions matérielles de ses travaux et de son administration. Toutes ces petites choses qui, au-delà de ceux qui la peuplent, représentent le « squelette de la Chambre4 ». Ce n’est pas un hasard si c’est sur un point de règlement que commence cette histoire. À travers le refus de siéger en formations séparées et l’imposition du vote par tête, bien plus que la procédure, c’est le sens même de l’Assemblée qui est en jeu. De ce sens que lui attribuèrent les députés du tiers état dépend l’existence du parlementarisme français. Derrière la révolution des pratiques parlementaires, il y a la Révolution.
Liens
Publié le 01/07/2025 ∙ Média de publication : Editions Passés Composés
L'auteur

Benjamin Morel