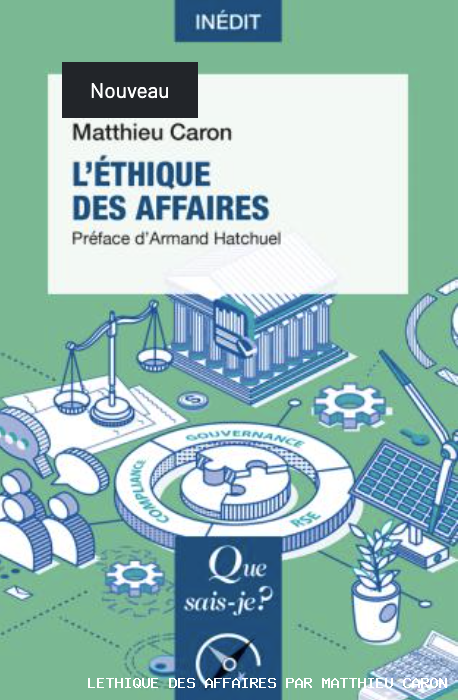L'Éthique des affaires
Quels sont les principes et les règles de l’éthique appliqués à la vie des affaires ? Quels sont les devoirs et les obligations des entreprises ? En résumé : comment articuler éthique et activité économique ? Voilà tout l’enjeu de l’éthique des affaires. Matthieu Caron propose à la fois une vision synthétique et pluri-disciplinaire de cette notion en faisant état de ses fondations, de ses déclinaisons, de ses mutations et de ses grands enjeux. Il nous montre que celle-ci peut être plus ou moins approfondie et transformationnelle pour les organisations selon l’outil retenu : la compliance, la responsabilité sociale des entreprises (RSE) ou la refondation de la gouvernance des entreprises (RGE). Il mène ainsi une réflexion postulant que l’éthique des affaires n’est pas une affaire de morale, mais une philosophie de la limite économique : la responsabilité, la dignité humaine et le bien commun priment l’intérêt individuel et le profit.
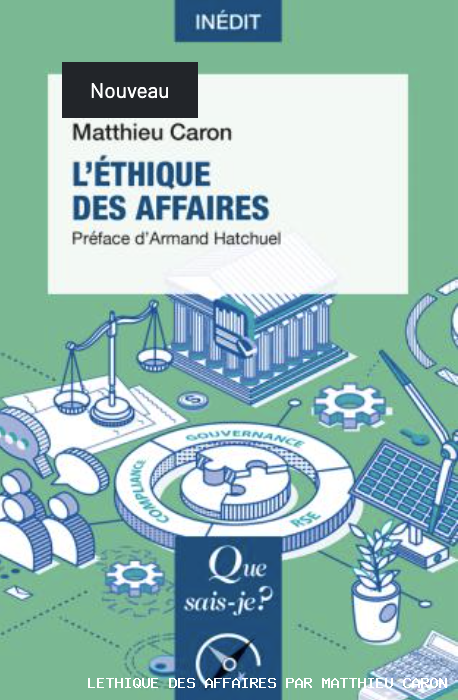
Cet ouvrage vient à point nommé, car l’éthique des entreprises connaît depuis quelques années un renouvellement théorique et juridique aussi important qu’inattendu. Mais pour comprendre la portée de ces développements récents, il faut retrouver la longue histoire de l’éthique des affaires, ainsi que les différentes significations que cette notion a pu revêtir avant de connaître une nouvelle mutation face aux défis contemporains.
C’est un tel périple que nous propose Matthieu Caron. Périple éclairant qui rappelle que l’éthique des affaires n’est pas une morale sans âge, mais plutôt un ensemble de débats, de doctrines et de lois qui ont façonné l’histoire des activités commerciales et productives, et ont contribué à chaque époque à leur développement et à leur – provisoire – acceptabilité.
Depuis les premiers âges du commerce aux plateformes numériques contemporaines, en passant par les grandes industries du XIXe siècle, l’histoire de l’éthique des affaires s’est donc construite en miroir des inventions techniques et des transformations de l’activité collective. Chacune de ces étapes a suscité des tensions et des interrogations, qui menaçaient à la fois la survie de ces nouvelles transformations et l’ordre des États qui les accueillaient. Le premier marchand qui n’a pas pu payer ses dettes ou a triché sur les marchandises vendues a probablement eu un destin funeste. On lui doit néanmoins la longue liste des règles qui, dès l’Antiquité, s’imposent aux commerçants, dont notre comptabilité est une lointaine héritière. Quant aux grandes manufactures anglaises mécanisées – qui à la fin du XVIIIe siècle incarnent la « révolution industrielle » –, elles inaugurent une « question sociale » toujours présente. Peu d’années après, elles engendrent des ingénieries juridique, scientifique et financière qui enclenchent la plus importante transformation de l’histoire de la planète. L’organisation scientifique du travail, les sciences de gestion et « l’entreprise moderne » naissent dans le sillage de ce tsunami civilisationnel qui transforme le travail comme le capital. Et dès la fin du XXe siècle, il est clair que l’éthique des affaires doit affronter la puissance de ces collectifs entrepreneuriaux. Or, face à cette lame de fond, la démarche éthique ne peut plus se limiter à un arrangement équitable entre des intérêts particuliers. Elle doit désormais affronter des menaces existentielles : car ces entreprises sont parfois plus puissantes que beaucoup d’États et leur activité peut mettre en danger les équilibres du vivant sur la seule planète dont nous disposons.
De façon synthétique et au plus près de ces grands moments historiques, Matthieu Caron nous décrit d’abord l’évolution de l’éthique des affaires, plus particulièrement aux États-Unis, où l’on tenta de la constituer en champ disciplinaire spécifique. In fine, ce champ ne pouvait s’autonomiser sans se couper des transformations du monde et des entreprises. En outre, il était traversé par des conflits théoriques d’autant plus tenaces que les questions éthiques interrogeaient les fondements des savoirs les mieux établis.
Matthieu Caron rappelle ainsi que la question de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises (RSE) a suscité d’importants travaux fondamentaux au cours des dernières décennies. Ces travaux ont révélé que la notion d’entreprise elle-même était restée un point aveugle du droit et des sciences économiques et sociales. En découle alors ce que l’auteur désigne comme le passage du mouvement de la RSE au mouvement de « la refondation de la gouvernance des entreprises » (RGE). La France a été pionnière de ce passage à travers sa recherche et avec l’instauration de dispositifs légaux novateurs (loi Pacte, sociétés à mission, devoir de vigilance…), dont l’auteur rappelle l’importance théorique et les principales répercussions.
Cet ouvrage est d’un grand mérite, et ce, à double titre. D’abord, il restitue une généalogie de l’éthique des affaires qui donne à cette notion une épaisseur historique particulièrement éclairante. Ensuite, il initie le lecteur aux recherches récentes qui, en peu d’années, ont bouleversé l’approche scientifique des entreprises ainsi que le droit des sociétés. Sur ces bases, il peut, en conclusion, esquisser quelques pistes futures pour cette nouvelle ère de la gouvernance des entreprises.
Peu de chercheurs pouvaient entreprendre une telle synthèse au croisement du droit, des sciences de gestion et de l’histoire industrielle. Il est heureux que, parmi eux, Matthieu Caron ait remarquablement relevé ce défi.
Armand HATCHUEL
Liens
Publié le 01/10/2025 ∙ Média de publication : Que sais-je ?
L'auteur

Matthieu Caron
Directeur général